
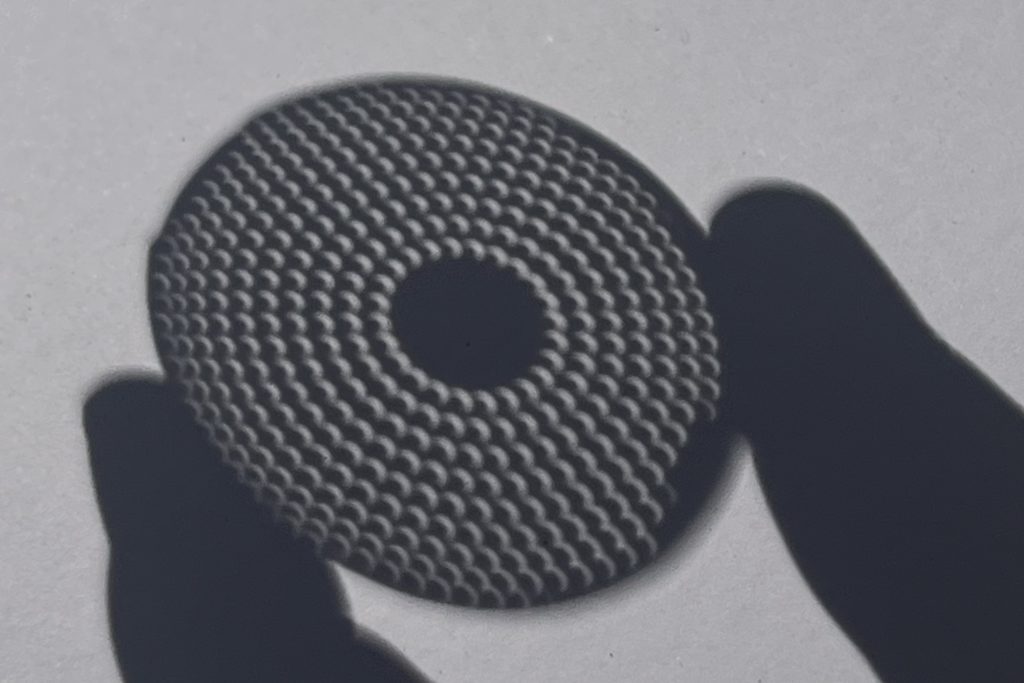
Laissons le bon temps rouler.

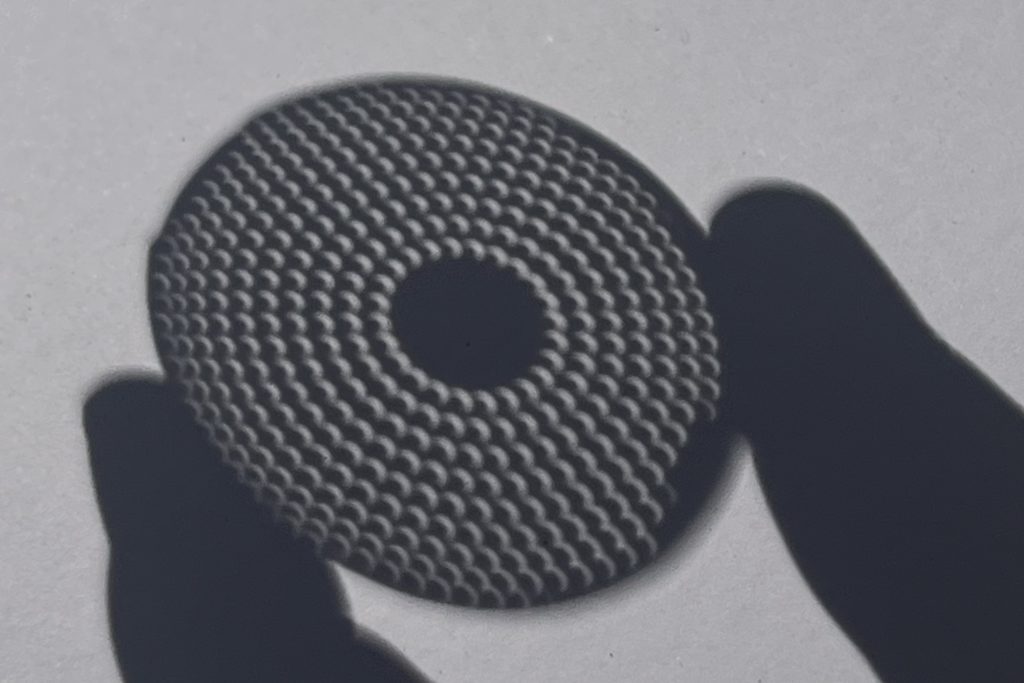



4 mois et deux demandes de process accéléré pour obtenir l’approbation, puis plus de deux semaines d’attentes que la carte soit fabriquée et expédiée. J’ai enfin mon autorisation de travail et j’ai toujours un boulot, mais pas encore de date de reprise.
Il est difficile de tirer les conséquences de ce genre de période, tant l’état d’esprit change au moment même où la solution arrive enfin. J’aurai pu voyager, randonner à vélo ou aller voir ma famille, mais je ne savais pas si mes économies étaient censées couvrir 2 semaines de vacances d’été ou 6 mois de dépenses élémentaires.
Je serai bientôt de retour au boulot, avec un salaire et 10 jours de vacances par an, me demandant pourquoi je n’ai pas pris ce vol pour Cancun la semaine dernière.
Je ne suis pas sûr que ce soit une vraie victoire, mais après ma première période sans emploi à notre arrivée ici, puis la courte période de recherche de boulot en Mai-Juin, puis cette interruption forcée cet été, je deviens un peu « meilleur » dans la gestion de ce genre de temps « off ».
Je suis certain que je pourrai faire un usage encore meilleur de mon temps, mais demandez à n’importe qui ayant connu une période de chômage et vous saurez que la priorité numéro 1 est de tenir le coup moralement, et je pense que de ce point de vue là, je m’en suis plutôt pas mal sorti.
Et cette force morale reste nécessaire une fois le boulot repris, pour rester bienveillant quand on regarde en arrière et qu’on se demande où sont passées ces semaines, ces mois et ces dollars.
Celui qui recommande de se serrer la ceinture et de ne pas dépenser 5 balles pour un café, une glace ou une bière n’a rien compris à ce que c’est d’être à la maison sans boulot. Passer une heure ou deux à discuter avec quelqu’un, en personne, n’est ni un perte de temps ni une dépense: c’est une bouée de sauvetage. Tout comme danser, lire, rouler. Here we come, members of the deadbeat club.
En 2018, Beyoncé est la tête d’affiche du festival Coachella. Le spectacle est un hommage à la culture des HBCU (Universités historiquement noires) et elle est accompagnée d’un brass band puissant, ouvrant le concert sur une reprise du « Rebirth Brass Band » de la Nouvelle Orléans.
(Le concert complet est dispo sur Netflix sous forme de reportage)
Depuis que je suis ici, ce « do watcha wanna »* est un peu partout: visuellement sur des t-shirts ou des affiches, et musicalement à chaque fois qu’un brass band joue. C’est à la fois un hymne et une devise de la ville.
Samedi, Jacques fêtait son anniversaire et a fait venir jouer sur son porche le Sporty’s brass band. Do watcha wanna.
Demain je vais pour la première fois au Superdome… voir Beyoncé!
J’étais allé au « On The Run » tour au Stade de France en 2014 et me souviens en être reparti avec une impression confuse et le sentiment que Beyoncé était devenue un produit marketing un peu vide. Après avoir été (opportunément?) « féministe » puis « BLM », l’écoute des paroles de son album « renaissance » m’a convaincu qu’elle n’avait pas grand chose à dire. « Apeshit » (sic) et le clip vidéo l’accompagnant, tourné au Louvre en 2018 étaient sans doute un avant goût: Beyoncé « règne » sur la pop mondiale mais n’est plus très inspirée. Do watcha wanna?
Si l’on en croit les communiqués de presse, « Renaissance » est un hommage à la dance music des années 70 (à laquelle elle a été introduite par son « oncle-gay-mort-du-sida »… queer baiting?). Je ne suis pas sûr d’accrocher à son hédonisme post-Covid, mais j’espère trouver demain au Superdome une énergie positive et dansante. Do watcha wanna.
(*pour « do what you want to »: « fais ce qu’il te plait »)



L’an dernier tout le monde s’est plaint de la gestion du bar et d’avoir dû attendre une éternité pour commander à boire. Moi aussi j’aurai aimé reprendre un verre, mais la musique était si bonne que j’avais passé malgré tout une excellente soirée et ce que j’avais surtout regretté était qu’ils aient éteint la musique et rallumé la lumière a 2h du matin. 1500 gays avaient alors traversé le CBD pour aller finir la soirée dans le Quarter. Je me souviens être allé sur le balcon du Queen’s Head siroter le gin tonic que je n’avais pas pu boire au Ace Hôtel.
Changement de lieu cette année, Horse Meat Disco a investi le Fillmore, sur Canal Street. Le bar était bien mieu géré, mais nul besoin de boisson quand la musique est si bonne. Plus de 5h de disco et Amber Martin sur scène a 2h pour chanter « Last Dance ».
On croit la soirée finie mais les platines continuent de chauffer, « McArthur Park », « Dont Leave Me This Way », « You Make Me Feel (Mighty Real) », la playlist est festive et joyeuse, et nous porte encore 45 minutes.
Je deviens sans doute un vieux con, mais ce set me semble tellement à des années lumières de ce qui se produit aujourd’hui. C’est mélodique, dansant, jamais vulgaire, il y a de la performance vocale, de l’émotion, de la poésie.
Merci!
L’an dernier la gay pride avait un petit air de réveillon: une occasion qui devrait être festive mais qui manque parfois de spontanéité ou semble forcée.
A chaque fois que je quitte NOLA je me demande pourquoi j’y habite. Et à chaque fois que j’y reviens je guette ces signes qui font que je me sens bien ici.
J’ai trouvé Paris et Nantes belles, j’ai traversé la première en Velib et exploré la campagne de la seconde en bonne compagnie. Les vignobles et le relief m’ont rappelé l’Alsace.
A Nola j’ai été accueilli par l’humidité lourde à la sortie de l’aéroport, sensation à laquelle je suis maintenant attaché. La chauffeuse de taxi sud coréenne n’en finissait pas de dire à quel point elle n’aimait plus la Nouvelle Orleans, et cherchait à comprendre pourquoi je me réjouissais que mon Visa ait été renouvelé 2 ans.
Je suis rentré chez moi, me suis douché, ai enfilé mon costume de pédé stéréotypé (short en jean, jockstrap, harnais et t-shirt en résille) et ai pris mon vélo pour aller en ville voir la parade. En chemin je croise K, intéressé par le groupe de vélo que j’ai lancé le mardi mais que je n’avais jamais rencontré. Au moment de garer mon vélo arrivent quelques amis qui se garent au meme endroit et m’invitent à les rejoindre sur un porche. Dans la parade j’aperçois quelques têtes connues: B me prend en photo, A me lance un collier arc-en-ciel, M me fait bonjour de loin. D’autres amis arrivent et tous vont manger, je file au Pub rejoindre un autre groupe, croise en chemin d’autres têtes connues.
Un couple défilait à la parade en mariés, l’un en robe blanche et l’autre en smoking, avec une pancarte espérant qu’on ne leur retirerait pas leur “I do”.
Hier j’ai enfilé un t-shirt par dessus ma tenue pour ne pas faire “trop gay”, et ne l’ai enlevé qu’une fois dans le Quarter. Certaines lois en cours de discussion nous menacent, et il y avait eu des rumeurs de contre manifestations, alors pour la première fois depuis que je suis ici, je me suis un peu censuré, je l’ai joué discret.
Baptiste parle de moi a l’école mais si la loi passe il se devra de re rentrer dans le placard au boulot, et je ne serai plus le bienvenu aux événements organisés par l’école.
Cette année la pride était plus militante que d’habitude, et j’ai pris cette parade et ces rencontres comme un “welcome home”, un de ces moments un peu magiques qui me font me sentir bien ici. J’étais si fatigué que j’ai à peine dansé et ai été très sage. Je suis rentré tôt, ai fait quelques courses sur le chemin du retour, me suis douché à nouveau et me suis couché.
Is home where Pride is?

“Another blessing is coming your way” m’a dit la voisine quand j’ai partagé avoir été licencié la semaine dernière.
Pour toute notre équipe c’était un choc mais pour la plupart des gens à qui j’en ai parlé ici, c’est presque un non événement: je suis intelligent et diplômé, je vais retrouver du boulot rapidement.
Le plus gros hôpital de la ville a licencié 800 personnes la même semaine, tout le monde connaît quelqu’un d’impacté. Vendredi soir j’annonçais la nouvelle et mon ami médecin a partagé comment il avait lui aussi eu une dure semaine et avait réanimé un patient. L’histoire du petit vieux a réanimer l’a emporté et personne ne m’a demandé comment je me sentais ni quels étaient mes plans pour la suite.
Aussi brutal que soit la rupture de contrat, on n’a pas d’autre choix que de rebondir: mon accès au réseau était désactivé immédiatement, dans les deux jours qui ont suivi j’ai signé les documents et renvoyé mon ordinateur. Mon CV et mon LinkedIn sont à jour, j’ai activé mes contacts et commencé ma recherche de boulot.
Je suppose qu’il existe un équilibre entre « se poser pour prendre un peu de recul » et « passer à autre chose le plus vite possible ». Ma tendance naturelle est évidemment la première option, et je me retrouve forcé d’adopter la seconde stratégie. Découvrir une autre culture ne passe définitivement pas que par le jazz et la gastronomie cajun.